
The Strokes: The new abnormal (2020) : The Strokes sont morts, vive The Strokes!
Deuxième chronique sur The Strokes, je frise la groupie confinée. Je réfute évidemment l’idée, mais en réfléchissant bien peut-être que… A l’issue de la première chronique, j’apprends avec une joie adulescente que le groupe viendra goûter la tomate de Marmande lors de la 24 -ème édition du Garorock (aujourd’hui ce n’est plus le cas). Ces dernières semaines, il était question d’un nouvel album au travers de leurs tweets. J’attendais, j’attendais et avant de me transformer en Dalida, le 10 avril 2020 la bête est sortie.
Heureux mais réservé (Est-ce un album en demi-teinte ou sur un succès du type This Is It…), les doutes s’estompent dès le premier morceau Adults are talking. On est vraiment sur la promesse faite en 2013 pour leur album Comedown Machine. Alors comment 20 ans après avoir ressuscité le rock (lire comment sur Travelzik), The Strokes ont-ils réussi à se ressusciter ?
L’excavateur : Rick Rubin
Derrière beaucoup de résurrections musicales aux Etats-Unis, il y a un homme Rick Rubin. Mi motard mi père noël, le palmarès de productions de cet homme impressionne encore plus que son physique à barbe blanche. Sans vouloir faire de litanie, on peut citer entre autres groupes : Beastie Boys, Run DMC, pour le hip hop, Slayer, Danzig ou Messiah pour le métal, mais aussi les Red Hot Chilli Pepers, System of Down… Bref Rick Rubyn est un pape de la production. Mais ce que j’y vois c’est sa capacité à faire rejaillir les talents chez les artistes.
Ainsi en 1993, il relance Johnny Cash et ensuite la carrière de Mick Jagger. 7 ans d’absence pour les autres Strokes, un producteur qui sait comprendre l’ADN d’un artiste pour le remettre au goût du jour, il n’en fallait pas plus pour faire sortir de terre l’album The New Abnormal. Rick Rubin agit comme le professeur qui rassemble des enfants dispersés pour en refaire une unité, The Strokes.
On prend les même et on recommence (mais en plus mature).
Premier ingrédient : la pochette. C’est une œuvre de Basquiat, Bird on Money. La pochette redevient à l’instar de This Is It un élément incontournable du projet.
Basquiat, Bird on Money

De plus, l’album repart sur un format assez court : 9 pistes pour 45 minutes d’écoute. C’est le format maîtrisé par le groupe. Les bases sont posées dès les premiers claps de batterie. Tout s’enchaîne sans pause. Tout est fluide, rappelant à l’envie la pochette de leur premier album, mi-coup, mi-caresse. Le groupe vous ballade pendant l’écoute aux sonorités post punk et électroniques. Les mélodies rappellent une new wave à la teinte New Order. Les hommages les moins voilés, presqu’à l’identiques sont pour Billie Idol Dancing with myself, dans leur prometteur hit Bad Decisions, mais aussi Psychedelic Furs the ghost in you pour Eternal Summer. L’électro assez présent sur l’album fait la belle à la collaboration du leader Julian Casablancas avec les Daft Punk.
Enfin, on notera que c’est l’album d’une certaine maturité, d’une certaine maîtrise. Sa cohérence est tenue jusqu’à la dernière chanson Ode to The Mets. Celle-ci sonne comme la promesse de futures retrouvailles, à l’instar de cet album. Techniquement, je ressens même que le fausset de Casablancas s’élève avec plus de justesse. Mais je m’attache à voir plus de rondeur, plus de nuance dans leur musique. Certains sons de batterie sont radoucis, les riffs de guitares plus mélodieux et les paroles plus abouties.
Si certains poids lourds de la critique comme pitchfork ou Le Monde voient un rendez vous manqué avec le groupe, le site Metacritic (qui recense les moyennes des critiques public et professionnels) lui affecte la note de 77 / 100 et 9,3 pour les utilisateurs. Je me joins à cet avis. Cet album est pour moi un vrai succès et un vrai aboutissement en terme de maturité sonore. A écouter d’autant qu’en ce moment on a le temps.
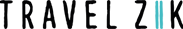

 Écouter en direct
Écouter en direct  Télécharger l'appli
Télécharger l'appli




